Identification d'un circuit cérébral impliqué dans l'autisme (étude)
GENEVE - Des scientifiques genevois ont identifié un circuit cérébral à l’origine des difficultés sociales des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme. Ces résultats, publiés dans la revue Molecular Psychiatry (DOI : 10.1038/s41380-025-02962-w), ouvrent la voie à des interventions plus ciblées.
On estime qu’un enfant sur 36 développe un trouble autistique, et qu’un tiers de cette population présente un risque de déficience cognitive, a indiqué lundi l'Université de Genève (UNIGE) dans un communiqué.
"Chez les enfants qui présentent un retard, les difficultés cognitives sont la conséquence d’un manque de compréhension des interactions sociales", indique Camilla Bellone, professeure associée au Département des neurosciences fondamentales de l’UNIGE, co-dernière auteure de l’étude.
Les jeunes enfants autistes qui s’orientent moins vers les indices sociaux dès la première année de vie développent moins les outils qui leur permettent d’apprendre, ajoute la spécialiste, citée dans le communiqué. Si les conséquences de cette absence d’intérêt social sur le développement sont bien connues, ses causes neurobiologiques le sont beaucoup moins.
Pour y voir plus clair, les scientifiques ont eu recours à des souris dépourvues du gène Shank3, un modèle reproduisant la forme monogénique la plus courante de trouble du spectre de l'autisme (TSA) connue chez l’être humain.
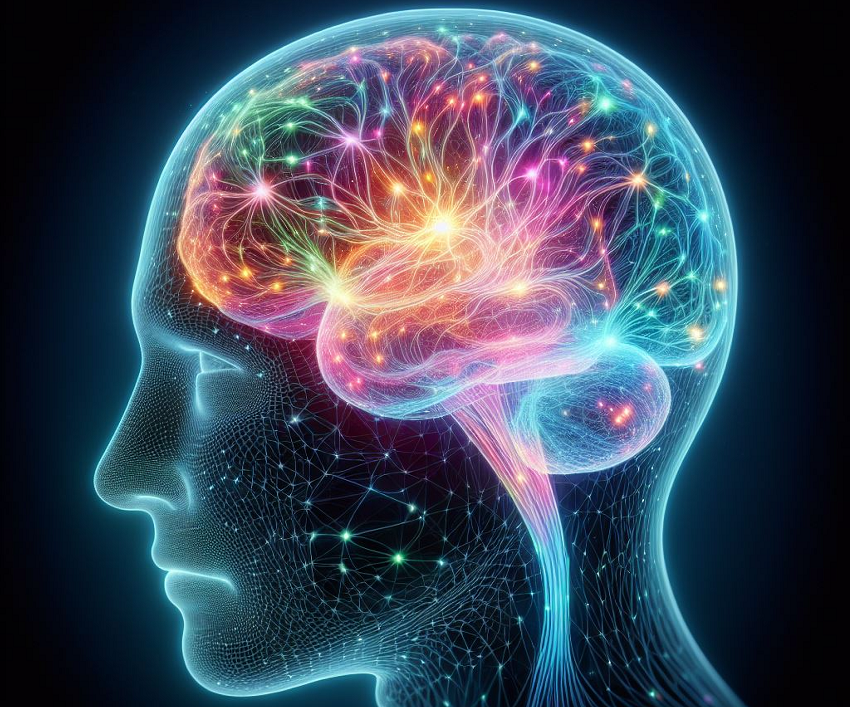 |
Altération de la synchronisation
Lors de précédentes recherches, l’équipe de Camilla Bellone avait identifié une voie de communication neuronale dont le rôle est d’envoyer des informations entre le colliculus supérieur, une structure cérébrale liée aux mécanismes d’orientation, notamment sociale, et l’aire tegmentale ventrale, liée au système de la récompense.
"Cette fois-ci, nous avons pu montrer chez nos souris-modèles du TSA qu’un manque de synchronisation des neurones du colliculus supérieur altérait l’échange de communication entre les deux aires cérébrales, avec pour conséquence des défauts dans l’orientation et les comportements sociaux", précise la chercheuse.
Pour confirmer cette hypothèse chez l’être humain, Nada Kojovic, co-première auteure de l’étude, a mis au point un protocole original pour obtenir des IRM cérébrales sans sédation avec des enfants de 2 à 5 ans.
"Nous avons aménagé la salle IRM et travaillé étroitement avec les familles pour offrir des conditions optimales pour que l’enfant s’endorme, ce qui fonctionne très bien pour plus de 90% des enfants pour qui nous avons obtenu des images IRM de très bonne qualité", dit-elle.
Interventions précoces
Résultat : les altérations identifiées chez les souris se retrouvent à l’identique chez les enfants. De plus, le niveau de connectivité de ce circuit permet de prédire leur évolution cognitive dans l’année qui suit.
Cette découverte pourrait ouvrir la voie à certaines interventions précoces pour renforcer la capacité des enfants à réorienter leur attention. Une méthode développée aux Etats-Unis et utilisée à Genève - 20 heures par semaine pendant deux ans – a déjà fait ses preuves : les enfants gagnent 20 points de QI en moyenne, et 75% d’entre eux peuvent ensuite suivre une scolarité ordinaire.
Le 14 avril 2025. Sources : Keystone-ATS. Crédits photos: Adobe Stock, Pixabay ou Pharmanetis Sàrl (Creapharma.ch).
